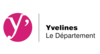Mohamed Diakhité a connu l’enfer de la migration forcée de la Guinée-Conakry vers la France, en passant par de nombreuses étapes traumatisantes au Mali et en Libye. Récit.
Ce mercredi 24 novembre 2021, 27 hommes et femmes ont trouvé la mort en voulant rejoindre l’Angleterre depuis les côtes calaisiennes. Mohamed Lamine aurait pu être l’un d’eux. Cette mort qui rôde, poisseuse et aveugle, il l’a côtoyée durant de longs mois entre l’Afrique de l’Ouest et Trappes. Oui, il l’a vue, souhaitée parfois, comme en Libye, avant de s’en remettre à la Providence. Désormais, il est là. Malgré l’illégalité de sa situation qu’il n’appartient pas à l’auteur de ces lignes de juger, il a tenu à parler. Pour la dignité ? Pour qu’il puisse faire entendre un souffle, une voix ? C’est ce que l’on pouvait attendre au moment d’ouvrir cette discussion, souhaiter même au regard de la désolation que pose la question migratoire à notre contemporanéité. Mais Mohamed LD ne dit pas ça. Il affirme vouloir témoigner à destination de son continent, un continent dont il constate le tropisme hexagonal : « Toujours en Afrique, on pense à la France. » Pensées si belles qu’elles créent à l’arrivée d’épouvantables dépits amoureux. Car la France ne peut plus ou ne veut plus accueillir. Mohamed LD ne juge pas du bien-fondé ou non de ce nouvel état de fait. Il brandit simplement la situation hérissée de toutes ces victimes avec l’espérance que cela cesse. Car ce portait, condensé terrible de la vie d’un homme qui en se livrant au cours de cet interview a ri, pleuré, hésité, maudit le ciel autant qu’il lui a rendu grâce, accuse la froideur des chiffres et l’obscénité des polémiques. Il est là, dans cette obscurité que la faible lueur de l’ampoule au-dessus de nous fait vaciller, de profil, le regard souvent perdu vers quelques horizons qu’il peine à décrire, les yeux nervurés de rouge, ces yeux, où comme l’écrit Aragon, réside son histoire et « cette conscience de l’abîme ».
« Je m’appelle Mohamed Lamine Diakhité »
Il est ce que la formule consacrée appelle « un migrant », « venu illégalement en France », un « sans-papiers ». Tous les jours, il entend le bruit de la machine médiatique l’évoquer par le truchement d’expressions administratives : « quotas », « seuils migratoires », « règlement Dublin III ». Pour lui cependant, la réalité est tout autre. Elle est une souffrance. Muré dans une chambre d’hôtel payé par l’État, miné par la solitude et en attente d’une décision préfectorale, Mohamed ne sait plus s’il doit espérer ou désespérer. La cruauté de l’isolement est telle, que couplée aux réminiscences de ses traumatismes d’exil, il est parfois sujet à des crises qui nécessitent l’intervention de la médecine psychiatrique.
Alors, par quoi commencer pour essayer de dire l’indicible, pour raconter ce que ses silences exigent de taire ? Il le sait. Il faut décliner son identité. Il la murmure d’une voix blanche, avec un accent hérité de son pays d’origine : « Je m’appelle Mohamed Lamine Diakhité. » En une seconde, ce balaie l’anonymat. Il donne un visage à cette silhouette fantomatique qu’on convoque et agite si souvent lorsqu’on parle « d’émigration ». Il ajoute : « J’ai 22 ans, je suis né en Guinée-Conakry » et précise qu’il existe « deux autres Guinée : la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau ». Puis il énonce : « Il faut savoir que la langue officielle de mon pays est le soussou, mais ma langue maternelle à moi est le diakhanké. » Le Français ne lui sera connu que plus tard, lorsqu’il l’apprendra ici, sur le territoire du drapeau tricolore. Ce qui l’a mené ici ? La petite et la grande Histoire. Son père, ingénieur dans le secteur florissant de la bauxite (cette roche forte en aluminium qui est le « trésor maudit » de la Guinée), meurt lorsque Mohamed est enfant. Homme prévoyant, il a toutefois veillé à lui léguer une maison, comme il l’a fait pour ses trois autres enfants. À sa femme, la charge de veiller à la juste répartition. Hélas, celle-ci succombe quelques années plus tard des suites d’un accident de la route alors qu’elle est en train d’effectuer un voyage de commerce. L’horizon se brouille pour Mohamed qui vient seulement de fêter ses 15 ans, l’héritage crée des envieux, à commencer par celui de son demi-frère. Fort de son appartenance à la garde présidentielle du nouveau dirigeant de la Guinée, Alpha Condé (2010−2021), il s’arroge des droits sur Mohamed, le spolie, l’empêche d’aller à l’école et le frappe. Alors Mohamed s’enfuit, ère, sombre dans la marginalité. « D’un coup, je me suis mis à fumer, parfois même de la drogue, à boire », avoue-t-il, gêné. Ce passage dans un monde dont il ignore tout le pousse aux extrêmes. Il a 15 ans. Un mauvais génie qu’il fréquente souffle sur les braises de son adolescence en feu et l’encourage, fusil en main, à se venger de son demi-frère. Mohamed prend l’arme qui peut faire de lui un meurtrier, se rend au-devant de son rendez-vous funeste mais à la vue de la fille de son demi-frère, réalise la folie qu’il est sur le point de faire. Caïn n’ôtera pas une seconde fois la vie à Abel.
« Sauve-toi, sauve ta vie »
Tout se sait néanmoins quand il s’agit d’affaire de famille. Cette simple prise d’arme est un franchissement de ligne rouge. Désormais, Mohamed est menacé de représailles par son demi-frère qui a juré sa mort. Une vieille amie de sa mère, au courant du péril, lui rend visite et lui donne de l’argent. « Elle m’a crié “Sauve-toi, sauve ta vie” », relate Mohamed. Jamais le double sens du verbe « sauver » n’est apparu si nettement. Il lui incombe de se sauver au sens de partir, pour se sauver au sens de mettre fin à ce cercle de perdition dans lequel s’est engouffré. Mohamed raconte ces événements avec beaucoup de douceur, sans jamais s’emporter. Tout au plus laisse-t-il jaillir quelques tchips. Mais, on le sent las, affecté, presqu’hagard là, à devoir re-convoquer tous les fantômes de son passé, à contempler les rouages de la machine infernale qui l’ont conduit, à partir d’une querelle de famille, sur les routes de l’enfer.
Il poursuit. « En août 2015, nous sommes d’abord partis avec un ami à Bamako », arrière-base de la migration transsaharienne. Là, il confie naïvement l’argent reçu par la bienfaitrice à une vague connaissance qui lui vole aussitôt. Extorsion qui hélas en appellera d’autres et que l’on retrouve dans presque tous les témoignages de migrants. Alors il lui faut travailler comme manutentionnaire dans un marché. « Je faisais du déballage et du remballage », explique-t-il. Cela durera un an. Puis, il prend les chemins du Nord du Mali où il exerce la fonction de berger auprès de Touaregs en attendant de pouvoir franchir la frontière algérienne car désormais il veut « se rendre en Europe, pour trouver la liberté ». Ce qu’il croit être sa « bonne fortune » survient quand il rencontre un passeur guinéen. Comment ne pas faire confiance à un compatriote ? Aux environs de Tin Zouatine et alors qu’il est poussé dans une cour, aligné au contact d’autres hommes, Mohamed comprend son leurre. Il s’agit d’un marché aux esclaves. Mohamed le sait, comme chacun d’entre nous, il existe des mots qui provoquent un effroi pareil à une écharde dans la chair, des mots qu’on pensait ne plus jamais lire, ne plus jamais dire. Lui ne les a pas simplement prononcés, il les a éprouvés et, garde une diction affligée quand il s’agit d’en expliquer le mécanisme : « J’ai été acheté mille euros. Ensuite, mon acheteur m’a emmené, mis dans une pièce et m’a demandé d’appeler ma famille pour leur dire qu’ils devaient envoyer 3000e afin que je sois libéré. » Mohamed décortique la prise de conscience de sa situation durant les trois premiers jours de son calvaire, la maltraitance, la certitude que sa famille ne fournira jamais les fonds ; il avoue ses pleurs : « On m’a tout de suite dit que ceux qui ne payaient pas, on les enterrait dans les déserts et… j’ai effectivement vu des squelettes. » Condamné, décidé à tenter le tout pour le tout, il profite d’une légère inattention de ses geôliers, saute par-dessus la clôture et s’enfuit en courant. « Je sais que j’ai été mis en joue, mais ils n’ont pas tiré. » S’ensuit une marche interminable à travers l’Algérie, un quotidien digne des Misérables où il côtoie l’engeance (un policier lui jette une tasse de café brûlant au visage) et la générosité (un militaire qui assiste à la scène intervient pour empêcher le policier d’aller plus loin et lui donne de l’argent afin qu’il s’achète de quoi manger), un passage vers la Libye sous une grande bâche, à l’arrière d’un camion. Ce pays, en proie au chaos, lui donne à voir le pire. Les vols, les viols, les crachats, les actes de torture, ceux qui appellent les noirs « abid » (esclave, en arabe). Mohamed, encore sous le choc et souhaitant évacuer cet épisode le plus rapidement possible, laisse entendre un racisme d’une violence inouïe : « Il n’y pas Dieu là-bas ; Dieu a quitté la Libye. »
Ici, on comprend la raison de cet acte en apparence insensé : prendre une embarcation précaire pour traverser la Méditerranée. Car tout paraît pour eux moins horrible que la Libye. Mohamed le pointe du doigt. Il détaille son arrivée sur la plage, les gens qui se pressent sur le premier bateau, son impossibilité de monter à bord. Il rapporte que ce premier bateau sert en même temps à ouvrir la voie, qu’il est en contact par téléphone avec celui qui suit. Soudainement, la voix au téléphone hurle : « On a entendu crier, crier, crier dans le téléphone », pleure Mohamed. Le bateau fait naufrage en direct, au son des SOS sans réponse. Aucun passager ne reviendra sur le rivage. Pourtant, Mohamed monte dans le second zodiac, pourtant, il s’élance dans les vagues et s’enfonce dans l’inconnu. Le plan des passeurs, remarque-t-il, « n’est pas de nous faire arriver à une destination précise, mais qu’on soit récupéré par des humanitaires quelque part en mer ». Ainsi le bateau dérive toute la nuit tandis que Mohamed et ses comparses « épongent avec une chemise l’eau qui rentre ». Il faudra attendre 7h du matin pour que surgisse un navire de la Croix-Rouge qui les récupèrera et les ramènera en Italie.
« Existe-t-elle, la terre promise ? »
« La première idée qui vient dans la tête », décrit Mohamed pour qualifier son départ de Libye, c’est que « je ne suis pas mort, Dieu est grand ». Il ajoute : « Je me suis retourné, j’ai regardé la mer, je me suis dit que j’avais pris beaucoup de risque mais… on préfère mourir dans l’eau, que l’eau nous mange, que les poissons nous mangent plutôt que de retourner en Libye. » Le voici en Europe. Non au Paradis. Cela fait deux ans qu’il a quitté son lieu de naissance. Placé dans une école abandonnée, il reçoit quelques vivres grâce à l’action conjuguée du gouvernement italien, de l’Église et des habitants locaux. Mais Mohamed ne se voit pas ailleurs qu’en France, alors par quatre fois, il va franchir la frontière en train et par quatre fois, arrêté par la police, il est ramené en Italie. « J’ai persévéré », martèle-t-il. En étudiant les horaires, en apprenant par cœur le moment des tours de ronde de la police pour déjouer sa surveillance. Cela lui permet d’atteindre Nice en train, puis Marseille, puis Paris en bus. Là, son récit prend les allures de celui d’Ulysse. Il se meut dans une longue errance de deux ans qui égrène des dizaines et des dizaines de villes fameuses (Rouen, Caen, Versailles) ou moins fameuses (Le Vésinet le Pecq, Carrières-sur-Seine). Errance où il parle de ses nuits dans la rue, de la faim, des chiens qui aboient et qu’il imite, de la solitude qui le rend fou, de la police qu’il le terrorise, des traducteurs qui ne disent pas ce qu’il voudrait qu’ils disent. Puis il s’arrête, il laisse choir l’heure la plus noire qu’il a vécue, celle qui souvent, au crépuscule, lui a fait penser que « Dieu ne veut pas de [lui] ». Il jette à nouveau dans le fond de la pièce un coup d’œil qui ressemble à un regard rétrospectif : « Depuis que ma mère est morte, je n’ai jamais connu le bonheur dans mon cœur. » Jamais, ou presque ? Car l’arrivée à Trappes en 2020 ressemble, sinon à la fin de sa quête, à sa première période d’accalmie. L’OFFI puis le 115 lui ont trouvé un logement dans la ville aux 32 000 habitants. Ici, il a rencontré des amis qui l’entourent, une dame bénévole qu’il considère comme une quasi-mère adoptive et dont il assure que sans elle, il serait « étendu sur les rails », des activités où il aide à distribuer de la nourriture ou des vêtements gratuitement. Jamais plus, il ne parlera de « terre promise ». Ce qu’il veut ? « La liberté. Peu importe le reste, le plus important, c’est la liberté. » Où ? En France ? En Afrique ? Alors que le cardinal Robert Sarah, lui aussi guinéen, vient d’en référer aux puissances occidentales pour « lutter contre le mal à la racine » en appelant à ce qu’on cesse de dire que « l’Europe c’est l’Eldorado » et en aidant l’Afrique « à se développer sur place » pour que les « jeunes trouvent du travail et restent chez eux », Mohamed songe-t-il au retour ? Il acquiesce. Une lueur se rallume en lui. La Guinée-Conakry, son Ithaque. Pourvu qu’il soit libre.
Thomas Jehan